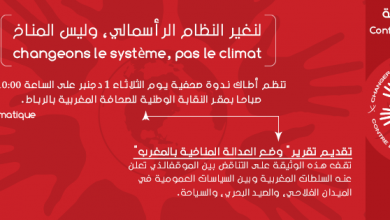« Notre Terre mère, militarisée, clôturée
, empoisonnée, témoin de la violation systématique
des droits fondamentaux, nous exige d’agir. » Berta Caceres[i]
Dans un monde dominé par un système capitaliste patriarcale colonialiste et raciste menaçant la vie des humains et de la nature non humaine, la notion de dette écologique requière un intérêt certain. Un intérêt pédagogique afin de rappeler les responsabilités et relier l’urgence climatique à l’urgence sociale. Un intérêt de justice pour les peuples du sud global qui ont subi et subissent toujours les conséquences des choix économiques, politiques et culturels décidés par une minorité parasitaire aux Nord et aux Sud. Un intérêt politique afin de lier la question écologique au colonialisme d’abord directe asservissant les peuples et les écosystèmes du Sud au nom d’une prétendue mission civilisatrice voire divine de l’occident, puis au néocolonialisme encourageant l’extractivisme des matières premières à partir de la périphérie vers le centre capitaliste au nom d’une prétendue « aide » au développement, au colonialisme vert perpétuant la dépendance et l’extractivisme au nom de la transition énergétique et le sauvetage de la planète.
Dans cet article, après avoir introduit la notion de dette écologique, j’essaierai de démontrer, en m’appuyant sur l’exemple marocain, en quoi la transition en cours n’est qu’un processus de légitimation du capitalisme vert, qui est d’un côté un nouveau type de capitalisme du désastre qui voit dans la crise apocalyptique climatique une opportunité de faire plus de profit, et de l’autre côté une nouvelle forme de colonialisme, un colonialisme vert qui profite du discours vert pour continuer le processus d’accumulation par dépossession entamé depuis la colonisation directe entreprise pendant les deux siècles précédents. Dans la dernière partie, je vais essayer de donner les contours d’une autre transition écologique, une transition juste pour et par les peuples.
La dette écologique : qui doit à qui ?
En préparant cet article, j’ai découvert que l’ex-premier ministre français de droite Michel Barnier, « a mentionné la « dette écologique » comme un enjeu central, au même niveau que la dette budgétaire » [2] , dans son discours de politique générale fin de l’année dernière. Il a utilisé ce concept pour souligner le fait que l’humanité vit aujourd’hui à crédit en ce qui concerne les GES (Gaz à effet de serre) que la planète est capable d’absorber !!
C’est une façon pour l’ex-premier ministre de noyer le poisson et demander une énième fois au peuple de payer la facture de cette nouvelle crise aux profits des capitalistes qui en sont les principaux responsables.
Cette opération de récupération de slogans et concepts développés dans la lutte par les peuples n’est malheureusement pas une exception. Tout au long de l’histoire, les classes dominantes ont récupéré les concepts produits par les opprimé·es pour exprimer leur aspiration à éliminer les injustices dont ils sont victimes.

Liberté, égalité, droits humains, souveraineté alimentaire [3] et même révolution sont des termes « appropriés » et « recyclés », puis vidés de leur sens véritable et neutralisés jusqu’à perdre leur pouvoir mobilisateur et leur symbolisme auprès des exploités.
Les classes dirigeantes commencent généralement à s’opposer à ces concepts et à les combattre. Cependant, face à l’insistance de « ceux d’en bas » et à l’intensification de leurs luttes pour obtenir satisfaction, elles changent de tactique en les adoptant après les avoir déformés.
L’accaparement de ces concepts par les classes dirigeantes, leur permet non seulement de remporter la bataille idéologique , mais aussi une légitimité symbolique conférée par leur adhésion à des idéaux humanitaires tels que l’égalité, la justice, la démocratie et les droits humains car ils semblent représenter les intérêts et les aspirations de tous les segments de la société.
Les concepts et termes liés aux questions environnementales n’ont pas été épargnés par ce processus. Nous avons récemment assisté à une attaque majeure contre les termes produits par les mouvements écologistes de la seconde moitié du XXe siècle, tels que « développement durable » ou « justice climatique » . C’est aujourd’hui au tour du concept de dette écologique.
D’un point de vue historique, le concept de dette écologique doit être considéré comme une réponse à la dette financière qui pèse sur de nombreux pays en développement. L’histoire officieuse de la dette écologique remonte au début des années 1990 et aux publications de l’ONG chilienne Instituto de Ecologia Politica (IEP) (Robleto et Marcelo 1992) : « Fini le pillage, ils nous doivent la dette écologique ! » (Acción Ecológica, 1999). La même année, lors de l’Assemblée annuelle des Amis de la Terre International à Quito, il a été décidé de lancer une campagne sur la dette écologique. Les efforts conjoints des Amis de la Terre International et d’Acción Ecológica ont conduit en 2000 à la création de l’Alliance des créanciers de la dette écologique des peuples du Sud (SPEDCA). Les objectifs de la SPEDCA sont triples. Tout d’abord, la SPEDCA appelle à une « reconnaissance internationale de la dette écologique, historique et actuelle ». Deuxièmement, ils appellent à « la reconnaissance de l’illégitimité de la dette extérieure, telle que démontrée par la dette écologique ». Troisièmement, ils formulent une série de revendications visant à réparer la dette écologique historique et à empêcher son aggravation future.
Les concepts d’empreintes écologiques et d’espace environnemental ont été développés par des scientifiques à la même époque, dans les années 1990.
Acción Ecológica affirme explicitement que la campagne « ne cherche pas :
• à donner un prix à la nature
• ni à commercialiser les “services environnementaux”
• ni à donner un prix au droit de polluer
• ni à promouvoir des “échanges dette contre nature”, car la dette extérieure est illégitime et a déjà été remboursée ».
Il s’agit de considérer que la dette extérieure du Sud envers le Nord a déjà été remboursée au titre de la dette écologique que le Nord doit au Sud, et d’empêcher que cette dette écologique ne s’accroisse davantage » « À titre de comparaison, la dette accumulée actuelle de l’Amérique latine s’élevait à 700 milliards de dollars US en 1999 (soit l’équivalent de seulement 12 ans de “dette carbone” à 60 milliards de dollars US par an) (…)
Par conséquent, la dette écologique ne prétend pas donner un prix à la nature, ce qui pourrait conduire à une marchandisation du vivant, mais évoque ou définit les responsabilités socio-environnementales et les obligations qui en découlent, dans un esprit de justice sur le plan de l’accès équitablement partagé aux ressources. Elle évoque ou invoque d’autres notions proches telles que celles d’inégalités écologiques, de solidarité écologique et de remboursement de la dette écologique, dans un esprit de « justice environnementale ».
La dette écologique se manifeste aujourd’hui dans plusieurs formes :
• Dette climatique (ou carbone) : émission des GES pendant des centaines d’années et dilapidation du budget carbon global par les pays du nord et leurs classes dominantes notamment les industries liées aux énergies fossiles.
• Biopiraterie : appropriation des savoirs traditionnels alimentaire et médicinale par les multinationales agroalimentaires et pharmaceutiques.
• Dette des déchets : exportation des résidus toxiques vers les pays pauvres. Par exemple le matériel impressionnant délaissé par le France au sud algérien, Environ 100 000 tonnes de matériel qui a servi aux expérimentations nucléaires françaises dans les régions de de Reggane et de d’In Ekker [4]• Dette historique coloniale : destruction des écosystèmes et des formes de vies y compris des êtres humains par l’intervention militaire et la suprématie occidentale dans l’« art » de tuer ! mais aussi la destruction liée à l’exploitation et l’envoie des ressources vers la métropol
• Dette néocoloniale : destruction des écosystèmes et des formes de vies y compris des êtres humains par la promotion et l’imposition de politiques extractivistes via des accords néocoloniaux de libre-échange, des conditionnalités imposé par le système dette ou encore la nécessité d’acquérir des devises pour traiter sur un marché mondiale dominés par les devises des pays impérialiste notamment les USA et les pays européens.
L’intérêt de la notion de dette écologique
• Le débat sur la durabilité tend à être exclusivement prospectif. La dette écologique met en lumière la manière dont la situation actuelle découle d’un passé souvent violent et injuste. Cette dimension historique ne peut être ignorée dans la quête d’un ordre mondial plus durable.
• De plus, le lien entre dette extérieure et dette écologique ouvre une nouvelle perspective politique aux relations internationales, renversant ainsi la relation créancier-débiteur. Le concept de dette écologique montre que les pays peuvent entretenir une relation créancier-débiteur sur la base de relations physico-écologiques. À travers le concept de dette écologique, les pays industrialisés et les pays en développement entretiennent une autre relation : le Nord est débiteur, le Sud est créancier. À titre de comparaison, le déséquilibre des échanges Nord Sud a été évalué à « 242 000 milliards de dollars sur la période 1990-2015 – une manne considérable pour le Nord, équivalente à un quart de son PIB. Parallèlement, les pertes du Sud dues à ce déséquilibre des échanges sont 30 fois supérieures au montant total de l’aide reçue sur la même période » [5]• La dette écologique est une autre façon de révéler l’impossibilité et le caractère indésirable de copier les trajectoires de développement des pays industrialisés.
• La mise en commun des expériences comparables des peuples du Sud.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
La reconnaissance implicite de cette dette existe depuis le Sommet de la Terre à Rio (1992) à travers le principe des « responsabilités communes mais différenciées ». Elle trouve un écho dès Stockholm en 1972, mais reste aujourd’hui largement ignorée dans les pratiques concrètes des institutions internationales.
Je crois que l’Accord de Paris a mis au deuxième plan cette responsabilité différenciée avec son modèle de NDCI (nationally determined commitments ..), parce que concrètement et depuis l’adoption de ce mécanisme, nous retrouvons que ce sont les pays les moins pollueurs qui ont les NDCI les plus ambitieux.
Pire encore, cette dette écologique n’a jamais cessé d’augmenter :
• 65 % des financements climatiques sont accordés sous forme de prêts [6] (et non des dons comme on le laisse croire dans les médias mainstream), ce qui revient à faire payer aux peuples du Sud les conséquences des émissions du Nord en plus des intérêts !! En 2022, pour 62 milliards de dollars de prêts pour l’adaptation climatique, les pays du sud ont dû payer 88 milliards de remboursement de dettes + les intérêts !! [7]• Selon Debt Justice, les pays à faible revenu dépensent cinq fois plus pour rembourser leur dette externe que pour protéger leurs populations face aux effets du changement climatique.
• Le FMI estime que la dette climatique (donc une fraction de la dette dite écologique) cumulée des pays du Nord de 1959 à 2035 dépasse 139 000 milliards de dollars, alors que les engagements annuels actuels n’atteignent même pas les 100 milliards promis [8] .
La dette climatique liée notamment aux phénomènes extrêmes (inondations, sécheresse, feu de forêt …) auxquels les pays de Sud global et leurs populations doivent faire face aujourd’hui, malgré leur non-responsabilité dans la crise climatique, doit être logiquement est légitimement payée par les pays du Nord et leurs multinationales.
Depuis quatre ou cinq années, on commence à parler dans les COP (que les gouvernements et les multinationales méprisent jusqu’ici) d’un fond de perte et dommage de réparation dont le budget est de 100 milliards de dollars. Inutile de rappeler que ce budget que les pays du Nord n’ont jamais respecté est très loin d’être suffisant lorsqu’on voit le la magnitude du désastre. A titre d’exemple, les inondations du Pakistan ont causé le déplacement de plus de 30 millions de gens et les dégâts matériels a été chiffré par le gouvernement pakistanais à 30 milliards de dollars.
Transition énergétique : un autre visage du colonialisme
Aujourd’hui, force est de constater que les classes dominantes, et surtout celles au Nord, mais avec la complicité des élites du Sud, réussissent malheureusement (jusqu’à maintenant), non seulement à faire payer le prix de la transition écologique aux plus pauvres, à ceux dont bas, mais aussi à profiter du narratif créée autour de cette prétendue « transition » verte pour accumuler des richesses et faire du profit dans ce qui s’apparente plus à un capital de désastre comme l’explique si bien Naomi Klein dans son agréable livre Théorie du Choc : capitalisme de désastre. [9]
Ce que les gouvernements appellent « transition verte » cache en réalité un capitalisme du désastre, technosolutionniste, où les capitalistes cherchent de nouvelles opportunités d’accumulation des profits sous prétexte de protéger l’environnement ou de combattre le changement climatique !
Mais c’est également un processus de recolonisation accompagné par :
• Un accaparement massif de terres en Afrique, notamment pour des projets solaires ou éoliens [10]• Des Partenariats publics-privés (PPP) imposés par des institutions financières (Banque mondiale, AFD, etc.),
• Une dépendance renforcée des pays du Sud envers les technologies, brevets et capitaux du Nord.
Pour illustrer ce qui précède je vais m’appuyer sur l’exemple marocain qui est présenté encore une fois comme pionnier dans ce qu’on appelle transition énergétique avec un plan des plus ambitieux de la région, avec un objectif de 52% de part des énergies renouvelable en termes de puissance installée [11], alors que l’énergie électrique réellement consumées reste malheureusement dominée par les énergies fossiles notamment le charbon [12] :

Cas du Maroc : transition énergétique ou perpétuation d’un processus d’accumulation par dépossession peint au vert ?
Selon la banque mondiale, 53 milliards de dollars sont requis pour la transition énergétique d’ici 2050 au Maroc. 7 milliards sont déjà dépensés, principalement en argent publique ou sous forme de crédits contractés ou garantis par l’Etat.
Qui paie ?
Il faut bien souligner que l’essentiel de cette facture de transition énergétique est payée par les citoyen·nes : hausse des tarifs, taxes, endettement ou encore le fond Hassan II issu des revenus de privatisations
Qui en profite réellement ?
Les principaux bénéficiaires sont d’abord les banques qui interfèrent dans toutes les phases de ces projets, imposent leur agenda et engrangent des bénéfices en liquidant leurs produits financiers (prêts, garantie, caution, green bonds ..etc) et récoltant des intérêts.
Le deuxième principal bénéficiaire sont les firmes multinationales telles que Engie, Siemens, Total Energie, et les classes dominantes marocaines et à leur tête, le holding royal avec sa branche « verte » Nareva qui contrôle plus de 90% du marché de l’éolien, ou encore le chef du gouvernement Akhenouch avec son holding Akwa et sa branche verte « Green of Africa » qui s’est fait octroyer avec le groupe espagnol Acciona le projet de réalisation de la plus grande station de dessalement d’Afrique à Casablanca.
Tous ces projets impliquent l’accaparement de terres et de territoires, avec une marginalisation totale et l’expulsion de la population locale, ainsi que l’épuisement de ressources en eau déjà maigres, comme dans le cas du projet Noor. L’accaparement de 3 000 hectares dans la région de Ouarzazate ce qui représente 10% de la surface de la ville et de 4 200 hectares dans la région de Midelt ce qui représente 31% de la surface de la ville.
Concernant le projet TotalEnergies d’hydrogène vert Chbika dans la région de Guelmim, l’attribution de 170 000 hectares (1 700km2, soit la surface de la ville de Guelimi ou de Londres) est en discussion, tout comme 150 000 hectares pour le projet pharaonique Exlink, qui prévoit d’approvisionner la Grande-Bretagne en énergie propre produite au Maroc. Il représenterait 8 % de l’électricité britannique et fournirait 7 millions de résident·es britanniques.

Il convient de noter que les autorités ont utilisé deux décrets des autorités coloniales françaises pour confisquer ces terres collectives : le décret du 27 avril 1919 et le décret du 18 février 2024, qui autorisaient la confiscation pour cause d’utilité publique et plaçaient la gestion du processus sous la supervision du ministère de l’Intérieur.

Extrait de l’EIES du projet Noor –
L’autre exemple concerne l’industrie d’automobile dite verte i.e la voiture électrique que beaucoup, y compris des militants écologistes, présentent comme la solution magique à la catastrophe climatique.
Depuis 2020, BMW est l’un des clients de Managem, bras minier du même holding Royal Almada. Renault a également conclu avec Managem un accord pour la fourniture de 5 000 tonnes de sulfate de cobalt par an, à partir de cette année 2025, permettant d’alimenter la production de 300 000 batteries pour véhicules électriques dans sa giga usine du nord de la France. [13]
Le cobalt, qui sert à produire des alliages et les cathodes des batteries des voitures électriques européennes, notamment celles de BMW et de Renault, est en partie extrait des galeries de Bou-Azzer, l’une des rares mine à partir du gisement primaire (cobalt pure dans la roche). Managem est, grâce à cette mine, est un des 5 premiers producteurs de cobalt au monde.
Contrairement aux annonces officielles des deux multinationales BMW et Renault, qui osent parler de cobalt responsable, l’extraction minière à Bouazzer se fait dans des conditions catastrophiques pour les humains (travailleurs et riverains), mais aussi pour la nature non-humaine. Les mineurs dénoncent leurs conditions de travail dangereuses, leur matériel vétuste et leur exposition systématique aux poussières toxiques.
Encore une fois, les politiques productivistes décidés par les élites principalement du nord sous le nouveau prétexte de transition énergétique sont conduites aux détriment des population du sud et des écosystèmes du sud, « sacrified zones & sacrified poeple » pour reprendre le concept utilisé par Naomi Klein dans son livre « This Changes Everything : Capitalism vs. The Climate »
Pour une transition populaire, anticoloniale et souveraine
La dette écologique est une dette envers les peuples (du sud global principalement) et la nature non humaine :
La dette écologique n’est pas une métaphore. C’est un appel à la justice historique, climatique et environnementale. Elle exprime :
• une remise en cause du modèle capitaliste extractiviste,
• une réaffirmation de la souveraineté des peuples notamment au Sud,
• un refus de toute marchandisation de la nature (cf. rejet des « marchés carbone », des swaps dette-nature, etc.).
Comme l’énonce bien Acción Ecológica :
« Nous ne mettons pas un prix sur la nature. Nous refusons que la dette écologique soit négociée comme un actif. »
Une transition écologique réellement juste suppose une transformation radicale du mode de production, de transport et de consommation capitaliste, elle doit intégrer nécessairement :
• La souveraineté populaire des communautés locales sur leurs territoires mais aussi sur tout projet alternatif et à toutes les étapes : design/conception, construction, mise en œuvre, exploitation et maintenance.
• Compensation des populations locales qui auraient accepté de céder leurs territoires et de supporter les impacts négatifs certains de tel projets en bénéficiant par exemple de tarifs préférentiels, voire de services d’électricité totalement gratuits mais aussi de priorité totale dans les emplois et la formation. Ces populations occuperaient des emplois hautement valorisée et non pas seulement le gardiennage, nettoyage et travaux de construction manuels !!
• La fin des projets géants et centralisés, au profit de solutions locales, décentralisées, adaptées aux besoins locaux et évitant les grandes distances de transport d’énergie avec toutes les pertes liée à la nécessites d’aménagement d’infrastructures adaptées.
• L’intégration des ouvrier·es, technicien·nes des installations et infrastructures énergétiques y compris celles polluantes, dans les alternatives encore une fois, dès le design. Ces ouvrier·es font partie de la solution et non du problème et il est impératif de gagner leur confiance
• La reconnaissance des peuples du Sud comme créanciers des dettes écologiques. Il est indécent de continuer à parler « d’aide de 100 milliards » du Nord envers le Sud. Il faut commencer à parler de dettes de plusieurs trillions (milliers de milliards) de dollars.
• Une socialisation du secteur de l’énergie comme bien commun : cogéré, non marchandisé.
• Des intégrations régionales au Sud et au Nord fondées sur les principes de solidarité et de complémentarité et non de concurrence et de spéculation !!
La dette écologique, c’est la mémoire des crimes environnementaux du capitalisme passés, présents et futurs. Elle réclame justice, pas charité. Elle refuse que l’avenir soit pensé sans le passé. Et elle rappelle que le paradis des riches s’est toujours bâti sur l’enfer des pauvres ; notamment au Sud global, ainsi que sur l’extermination d’autres formes de vie et mise en danger des équilibre fondamentaux des écosystèmes terrestres.
Les alternatives doivent être discutés et construite avec les communautés locales qui luttent depuis toujours pour la défense de leurs territoires. L’alternative viendra d’abord des luttes populaires, des peuples du Sud, de leur mémoire, leur courage et leur créativité. Nous dévons répondre alors à l’appel de Thomas Sankara de ne pas laisser aux oppresseurs le monopole de la créativité et de commencer à penser par en bas avec les gens d’en bas les possibilités d’un autre monde et une autre humanité possible et nécessaires aujourd’hui plus que jamais !
Par M. Jawad – Bruxelles, Octobre 2025
[i] Berta Isabel Cáceres est une militante écologiste hondurienne, dirigeante indigène, cofondatrice et coordinatrice du Conseil des organisations populaires et indigènes du Honduras (COPINH). Elle a reçu le prix Goldman pour l’environnement, en 2015 pour « une campagne de terrain qui a réussi à contraindre le plus grand constructeur de barrages au monde à se retirer du barrage d’Agua Zarca » sur le Río Gualcarque. En 2016, elle a été assassinée à son domicile par des intrus armés, après de nombreuses années de menaces de mort. Un ancien soldat des forces spéciales honduriennes entraînées par les États-Unis a affirmé que le nom de Cáceres figurait sur leur liste noire depuis des mois avant son assassinat.
[ii] Discours de Michel Barnier : un message fort envoyé sur la dette écologique Lesechos.fr – Octobre 2024
[iii] Au moment où le régime marocain a longtemps implémenté des politiques agricoles orientés vers l’export et qui ont approfondi notre dépendance alimentaire, les responsables osent de considérer le slogan « Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire » comme thème de la prochaine édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) qui aura lieu fin avril 2026 à Meknès. Voir plus de détails sur le site officiel su SIAM
[iv] « Les déchets des essais nucléaires français en Algérie Sous le sable, la radioactivité ! Analyse au regard du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires » – JEAN-MARIE COLLIN ET PATRICE BOUVERET Publié par la Fondation Heinrich Böll, juillet 2020
[v] “Imperialist appropriation in the world economy: Drain from the global South through unequal exchange, 1990–2015” Jason Hickel, Christian Dorninger, Hanspeter Wieland&Intan Suwandi -March 2022
[vi] CLIMATE FINANCE SHADOW REPORT 2025 ANALYSING PROGRESS ON CLIMATE FINANCE
UNDER THE PARIS AGREEMENT – Oxfam – October 2 0 2 5
[vii] Idem
[viii] « Régler la dette climatique » Benedict Clements, Sanjeev Gupta et Jianhong Liu – Septembre 2023
[ix] La Stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du désastre (titre original : The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism) Naomi Klein – 2007
[x] Colonialisme vert : 70 % des minéraux nécessaires aux énergies renouvelables se trouvent dans les pays du Sud, mais les profits vont majoritairement aux pays les plus riches Rapport Oxfam Septembre 2025
[xi] C’est la somme totale de la capacité maximale de production de toutes les installations électriques renouvelables (centrales solaires, parcs éoliens, hydraulique etc.), mesurée en watts (W). Elle représente la capacité maximale d’électricité qu’on peut potentiellement produire et livrer si tout va bien ! et non l’énergie produite réellement qui est généralement bien inférieure.
[xii] Le secteur énergétique marocain l’éternelle dépendance M.Jawad * TNI – Decembre 2021
[xiii] Mines au Maroc : la sinistre réalité du « cobalt responsable » – reporterre.net – Juillet 2023